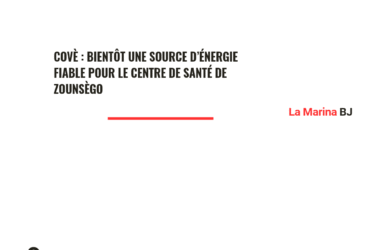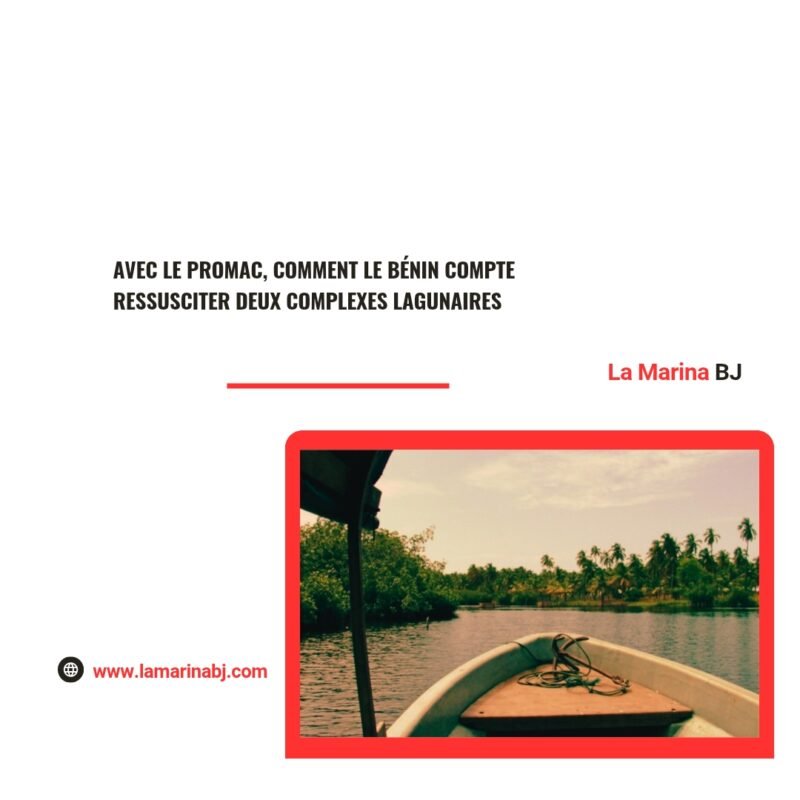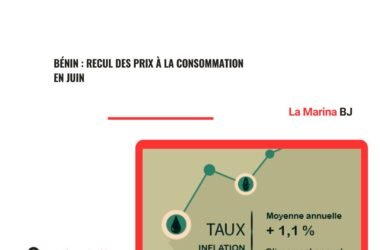Aquaculture, Bénin – Sous pression environnementale depuis quelques années, les deux complexes lagunaires du Sud-Bénin font aujourd’hui l’objet d’une attention stratégique. Grâce à un financement de la Banque africaine de développement (BAD), obtenu dans le cadre du Projet de Promotion de l’Aquaculture et de la Compétitivité des Chaînes de valeur (PROMAC), le gouvernement béninois entend amorcer un tournant décisif. Celui de relancer les dynamiques écologiques, sociales et économiques de ces espaces fragiles à travers l’installation de réserves biologiques conçues avec et pour les communautés locales.
Selon nos informations, le ministère de l’Agriculture, de l’Élevage et de la Pêche s’apprête à lancer une double étude — technique et environnementale — visant à réhabiliter les frayères naturelles et à implanter de nouvelles réserves biologiques. Ce travail débutera par une évaluation approfondie des dispositifs communautaires mis en place par le passé sur les deux complexes. L’idée est de tirer des enseignements des expériences antérieures pour bâtir un modèle plus résilient et mieux adapté aux réalités locales.
Les équipes mandatées devront réaliser un diagnostic participatif rigoureux afin d’identifier les sites les plus propices à la régénération des écosystèmes halieutiques. Il leur reviendra également de proposer des modèles de réserves à implanter, en tenant compte des spécificités écologiques de chaque site. En bout de chaîne, sont attendus : des devis quantitatifs et estimatifs, un dossier cartographique précis, ainsi que des outils de suivi.
Encadrer, suivre, certifier
Mais la démarche ne s’arrête pas à l’ingénierie écologique. L’approche repose aussi sur le respect strict des exigences environnementales et sociales. Des études d’impact sont prévues, dont les conclusions seront soumises à l’Agence béninoise pour l’environnement (ABE) en vue de l’obtention des certificats de conformité requis. Ces documents conditionneront le démarrage effectif des aménagements.
Ce volet réglementaire est essentiel pour inscrire le projet dans la durée et en garantir la légitimité auprès des acteurs publics comme privés. La responsabilité de la restitution des rapports d’impact environnemental et social, ainsi que leur validation finale, incombera au bureau d’études mandaté.
Réconcilier écologie et développement local
Derrière ce chantier, le gouvernement affiche une ambition forte. Selon une source proche de la coordination du PROMAC, il s’agit de « réconcilier la préservation des ressources naturelles avec le développement des communautés riveraines ». Les réserves biologiques visent à restaurer les cycles de reproduction halieutique, à sécuriser les revenus des pêcheurs artisanaux, et à jeter les bases d’une aquaculture durable. À terme, ces deux études — dotées d’un budget de près de 31 millions de francs CFA — contribueront aussi à la création d’emplois, à l’amélioration de la sécurité alimentaire, et à une meilleure valorisation économique des produits de la pêche.
Lancé le 15 mai 2024, le PROMAC s’inscrit pleinement dans cette dynamique de transformation. Il vise à renforcer la contribution du secteur de la pêche et de l’aquaculture aux économies locales et nationales, ainsi qu’à la sécurité alimentaire, en misant sur la promotion de l’aquaculture, la gouvernance des pêches et l’amélioration de la valeur ajoutée du poisson.
Restez connectés à l’actualité en temps réel en rejoignant notre chaîne WhatsApp pour ne rien manquer : actus exclusives, alertes, et bien plus encore.