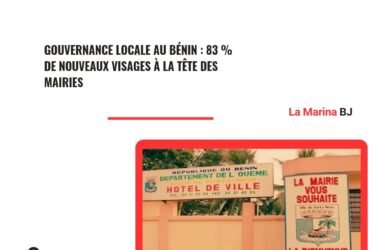Hydraulique, La Marina BJ – Alors que le gouvernement béninois accélère la mise en œuvre de ses grands chantiers d’accès à l’eau potable, le projet de renforcement du système d’alimentation en eau potable des villes de Lokossa, Athiémé et environs aborde une phase déterminante : celle du suivi environnemental et social. Financé dans le cadre d’un accord de prêt signé le 23 octobre 2024 (En savoir plus ici ) avec la Banque Ouest Africaine de Développement (BOAD), le programme amorce une approche inédite de gouvernance environnementale, destinée à garantir la conformité, la transparence et la durabilité de ses interventions.
Dans un département marqué par une forte pression démographique et une demande croissante en eau, le projet vise à sécuriser l’accès des populations urbaines et périurbaines à une ressource de qualité. Mais au-delà des infrastructures physiques — forages, stations de traitement, conduites d’adduction —, l’État béninois entend désormais consolider la dimension environnementale de ses investissements publics.
Le dispositif mis en place permettra de suivre, évaluer et corriger les impacts des activités sur les écosystèmes et les communautés locales. Conformément à l’usage, il ne s’agit plus seulement de construire, mais de s’assurer que chaque chantier respecte les normes environnementales nationales et les standards de la BOAD en matière de sauvegarde écologique et sociale.
Des mécanismes de suivi et de redevabilité intégrés
Pour cette mission, qui sera exécutée par un ingénieur en sciences environnementales justifiant au moins dix années d’expérience professionnelle pertinente dans le domaine de l’évaluation environnementale et sociale (un contrat évalué à 72 millions de FCFA), le dispositif de gouvernance prévu s’appuie sur plusieurs outils. D’abord, un plan cadre de suivi environnemental et social sera mis en œuvre afin d’identifier les risques, d’en atténuer les effets et de mesurer en continu la performance du projet. Ensuite, un mécanisme de gestion des plaintes permettra aux populations riveraines, aux travailleurs et aux parties prenantes d’exprimer leurs préoccupations et d’obtenir des réponses documentées.
Des rapports trimestriels seront élaborés en collaboration avec les acteurs impliqués pour garantir un pilotage participatif et une transparence totale. Deux audits indépendants viendront parachever ce dispositif en évaluant la conformité et la qualité des mesures environnementales adoptées.
De la conformité technique à la responsabilité publique
L’objectif poursuivi par la Société Nationale des Eaux du Bénin (SONEB), qui pilote le projet, est de faire de la durabilité environnementale une exigence de gestion publique, et non un simple volet accessoire des projets d’infrastructure. La supervision des chantiers comprendra ainsi un contrôle systématique du respect des règles d’hygiène, de sécurité et d’environnement (HSE). Les équipes techniques seront sensibilisées à la prise en compte de ces enjeux dès la planification, tandis qu’un registre de doléances permettra de consigner et de résoudre les incidents liés à la mise en œuvre.
Ce cadre marque une rupture avec la logique antérieure, où les aspects sociaux et environnementaux étaient souvent traités en aval. Il consacre une approche intégrée, conforme aux standards internationaux de gouvernance durable.
Notons enfin que cette démarche du projet s’inscrit dans la vision stratégique du gouvernement béninois, qui vise l’accès universel à l’eau potable d’ici 2030, tout en conciliant développement, inclusion et préservation des ressources naturelles. Dans le Mono, cette ambition prend corps à travers une politique d’investissement où la performance technique s’accompagne désormais d’un impératif : celui de la responsabilité environnementale.
Restez connectés à l’actualité en temps réel en rejoignant notre chaîne WhatsApp pour ne rien manquer : actus exclusives, alertes, et bien plus encore.