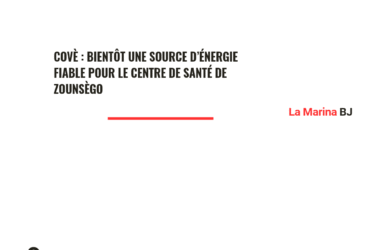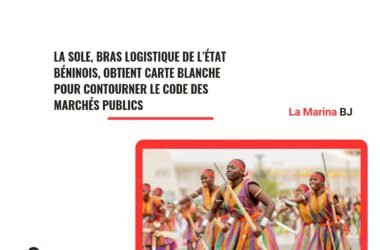Gouvernance, La Marina BJ – Entre 2022 et 2024, les établissements publics béninois ont accéléré leur modernisation sous l’impulsion des réformes structurelles engagées par le gouvernement de la rupture. Digitalisation, amélioration de la gouvernance, montée en compétences… ces avancées traduisent une mutation réelle du service public. Pourtant, la dépendance financière vis-à-vis de l’État demeure forte, freinant l’autonomie et la performance durable du secteur. C’est l’un des constats majeurs de la dernière note analytique sur les entreprises publiques, publiée en annexe au projet de loi de finances pour la gestion 2026.
Entre 2021 et 2025, le nombre d’établissements publics recensés est passé de 55 à 72. Cette évolution traduit une politique d’extension encadrée, visant à mieux outiller l’État dans la mise en œuvre de ses politiques sectorielles. Le cadre juridique, fixé par la loi n°2020-20 du 02 septembre 2020, a renforcé la cohérence et la transparence de la gestion publique. Sous la supervision du ministère de l’Économie et des Finances (MEF) et de la Direction générale des Participations de l’État et de la Dénationalisation (DGPED), les établissements bénéficient désormais d’une surveillance financière et d’une gouvernance resserrée. En parallèle, la généralisation de la gestion budgétaire par programmes, couplée à une meilleure coordination entre les ministères et la Présidence, permet de clarifier les responsabilités tout en alignant les ressources sur les priorités nationales. Cette évolution conforte la place des établissements publics comme instruments opérationnels de la politique de développement.
La mutation la plus marquante de ces trois dernières années réside dans la montée en puissance du numérique au sein de l’administration publique. La note analytique souligne que le secteur tertiaire concentre désormais 85 % des établissements publics, avec une percée significative du secteur quaternaire — innovation, recherche et digitalisation — qui dépasse désormais le secteur secondaire en représentativité. Cette transformation est portée par des structures phares telles que la Société Béninoise d’Infrastructures de Radiodiffusion (SBIR SA), la chaîne A+ Bénin ou encore l’Agence de Développement de Sèmè City (ADSC). Ces acteurs traduisent la volonté du gouvernement de moderniser la gestion administrative, de dématérialiser les procédures et de diffuser la culture de la performance. La digitalisation n’est plus une option : elle devient le moteur de la réforme publique et un levier central de la transparence financière.
Une performance budgétaire contrastée
Sur le plan budgétaire, les trois dernières années offrent un tableau contrasté. Les recettes globales des établissements publics sont passées de 113,6 milliards FCFA en 2022 à 134,7 milliards en 2024, soit une hausse de près de 19 %. Cette progression s’explique par une meilleure mobilisation des ressources propres et une gestion plus rigoureuse des transferts étatiques.
Toutefois, la dépendance vis-à-vis du budget national reste structurelle : 72 % des ressources totales proviennent de l’État. Les recettes propres, bien qu’en croissance (de 24,1 à 31,9 milliards FCFA), ne couvrent toujours pas un quart des besoins de fonctionnement. La faiblesse des revenus générés par les prestations marchandes illustre la difficulté des établissements à valoriser leurs services et à s’autofinancer durablement. En somme, la modernisation administrative ne s’est pas encore traduite par une véritable autonomie économique.
Des investissements irréguliers et une rentabilité fragile
Les dépenses totales des établissements publics ont connu une trajectoire oscillante : 105 milliards FCFA en 2022, 107 milliards en 2023, puis 85 milliards en 2024. Après un pic d’investissements à 45 milliards en 2023, impulsé par la construction d’infrastructures dans les secteurs de l’éducation, du numérique et du cadre de vie, la tendance s’est inversée en 2024, marquée par la fin de plusieurs chantiers majeurs.
Le résultat net consolidé, lui aussi, reflète cette volatilité : 3,19 milliards FCFA en 2022, 4,17 milliards en 2023, puis un recul à 2,97 milliards en 2024. Cette baisse traduit un essoufflement de la rentabilité après une phase d’expansion. Le ratio charges/produits, passé de 90,9 % à 94,1 % sur la période, montre que la maîtrise des coûts reste un enjeu clé. L’effort d’assainissement engagé par le ministère de l’économie et des finances doit désormais viser une meilleure corrélation entre dépenses publiques, investissements productifs et gains de performance.
Les projections financières établies pour le triennat 2026–2028 laissent entrevoir une trajectoire prudente mais optimiste. Les produits devraient passer de 402,9 milliards FCFA en 2026 à 452,9 milliards en 2028, tandis que les résultats nets progresseraient de 122,5 à 138,5 milliards FCFA, soit une hausse de 12,9 %. Ces perspectives reposent sur trois leviers majeurs : la poursuite de la rationalisation budgétaire, la digitalisation intégrale des services publics et la consolidation de la gouvernance financière. Le défi central demeure cependant celui de la viabilité économique : transformer les établissements publics en entités capables de générer des excédents sans compromettre leur mission d’intérêt général. C’est là que se joue la crédibilité de la réforme publique à moyen terme.
Pour finir, les établissements publics fonctionnent encore dans une logique d’assistance budgétaire, alors même qu’ils disposent désormais d’outils de gestion et de capacités techniques modernes. La réussite de la prochaine étape des réformes dépendra de leur capacité à créer de la valeur, à diversifier leurs sources de financement et à s’inscrire durablement dans une économie publique performante et responsable.
Restez connectés à l’actualité en temps réel en rejoignant notre chaîne WhatsApp pour ne rien manquer : actus exclusives, alertes, et bien plus encore.