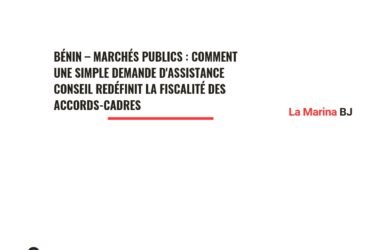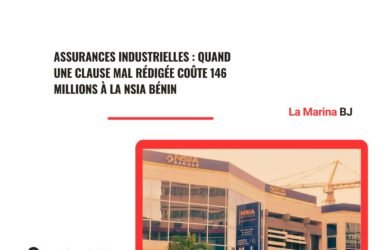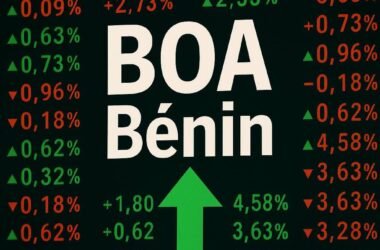Agriculture, Bénin – Loin des slogans de relance ou des bilans conjoncturels, un rapport publié par la Direction générale de l’Économie, sur la période 2017-2022, révèle avec précision les performances, les fragilités et les perspectives de la filière anacarde. Entre contribution mesurée au PIB et emploi largement précaire, le Bénin joue gros dans sa volonté de faire de la noix de cajou un levier industriel.
Dans la hiérarchie des cultures d’exportation béninoises, la noix de cajou occupe une place singulière. Longtemps cantonnée à une production brute peu valorisée localement, l’anacarde suscite aujourd’hui de fortes attentes politiques et économiques, notamment dans le cadre de l’agenda de transformation structurelle du pays. Mais au-delà des ambitions, que représente vraiment la filière dans l’économie nationale ? C’est la question à laquelle répond le rapport « Contribution de la filière anacarde à l’économie béninoise », publié le 23 juin 2025 par Direction de la Recherche et des Études Stratégiques (DRES) et la Direction générale de l’Économie (DGE) du Ministère de l’Économie et des Finances (MEF). [(Rapports et études 2025-N°3)].
Un poids réel mais encore marginal
Sur la période 2017-2022, la filière a généré une contribution moyenne de 2,45 % à la valeur ajoutée du secteur primaire, avec un pic de 3,36 % en 2018. Si elle conserve une place stratégique dans le portefeuille agricole du pays, cette part reste modeste en regard du potentiel proclamé de la culture. L’évolution est de surcroît marquée par une variabilité importante, liée aux aléas climatiques, à l’instabilité des rendements et à une structuration insuffisante de la filière.
La transformation locale, quant à elle, demeure faible malgré quelques signaux positifs. Sur la même période, la contribution au secteur secondaire n’a atteint en moyenne que 0,85 %, avec une nette progression en 2022 (1,17 %) grâce à l’entrée en service de nouvelles unités industrielles, notamment dans la Zone Économique Spéciale de Glo-Djigbé (GDIZ). Mais cette dynamique reste encore embryonnaire par rapport aux volumes exportés à l’état brut.
Côté secteur tertiaire, les activités de commercialisation et de distribution ont représenté 1,06 % de la valeur ajoutée en moyenne, une performance qui reflète le rôle de l’anacarde dans les exportations agricoles, mais aussi ses limites structurelles en matière de valorisation commerciale.
Une exportation forte, une transformation faible
Sur les années analysées, les exportations d’anacarde ont constitué 12,07 % des exportations agricoles totales du Bénin, loin devant des produits comme le karité (4,36 %), le soja (1,26 %) ou l’ananas (0,18 %). Pourtant, la transformation industrielle locale demeure marginale, dominée par des procédés artisanaux ou semi-industriels, avec un encadrement encore insuffisant.
L’interdiction d’exportation des noix brutes, entrée en vigueur en 2024, vise justement à inverser cette dynamique. Elle pourrait favoriser une intégration verticale de la chaîne de valeur, à condition que les investissements industriels soient accompagnés d’un effort massif de formation, de logistique et de structuration des producteurs.
Un levier social à double tranchant
Socialement selon le rapport consulté par La Marina BJ, la filière emploie plus de 200 000 personnes à travers ses différents maillons. Les femmes représentent 54,3 % de cette main-d’œuvre, essentiellement concentrée dans les segments les moins valorisés : collecte, transformation manuelle, conditionnement. Mais derrière cette contribution à l’emploi rural, se cache une réalité plus préoccupante : 70,4 % des travailleurs sont en situation précaire, sans contrat formel, sans sécurité sociale, et très souvent employés à la tâche.
Les inégalités sont également marquées entre les genres : 76,3 % des femmes du secteur exercent un emploi temporaire, contre 63,4 % des hommes. Seuls 8,9 % des travailleurs sont affiliés à la sécurité sociale, et moins de 8,1 % disposent d’un contrat de travail formel. « La filière crée des emplois, mais peu de travail digne », résume notre spécialiste à la rédaction.
Le tournant industriel est-il engagé ?
L’essor de GDIZ et la montée progressive des capacités de transformation donnent à penser qu’un tournant est amorcé. Mais le rapport appelle à la prudence : sans réforme de la gouvernance, sans renforcement des coopératives, sans accès au financement et à la formation, l’industrialisation du secteur pourrait rester inaboutie.
Selon le rapport, l’anacarde pourrait devenir un vecteur de développement durable, en contribuant à la réduction de la pauvreté rurale, la résilience climatique, l’industrialisation agricole et la promotion de l’entrepreneuriat féminin. Encore faut-il que le pays réussisse à articuler ses ambitions avec une stratégie de transformation à la fois inclusive, productive et compétitive.
Restez connectés à l’actualité en temps réel en rejoignant notre chaîne WhatsApp pour ne rien manquer : actus exclusives, alertes, et bien plus encore.